Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan – Naïve

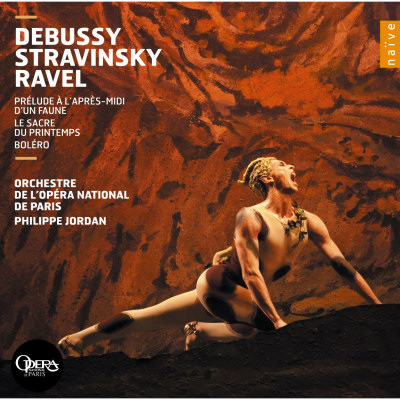
Continuer la lecture de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan
Musique classique
Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan – Naïve

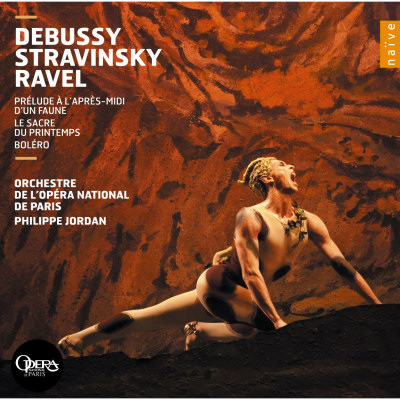
Continuer la lecture de Claude Debussy – Prélude à l’après-midi d’un faune – Philippe Jordan
L’impressionnisme et la musique – English
Charles-Valentin Alkan – Pascal Amoyel – La dolce volta
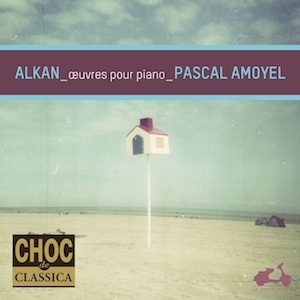
Continuer la lecture de Charles-Valentin Alkan – Pascal Amoyel
Rafael Kubelik – Complete Masterpieces
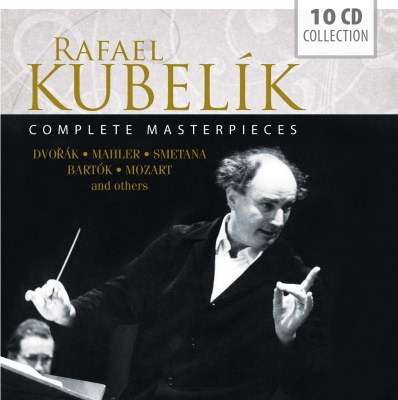
Continuer la lecture de Rafael Kubelik – Complete Masterpieces
Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony
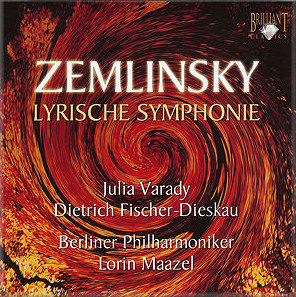
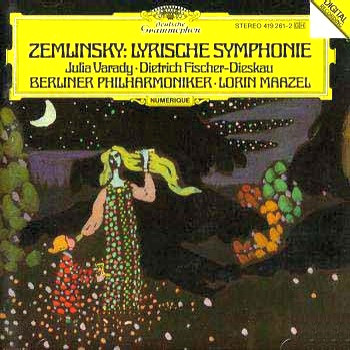 Continuer la lecture de Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony
Continuer la lecture de Alexander von Zemlinsky – Symphonie lyrique – Lyric symphony
Continuer la lecture de N’oublions pas les amateurs – Chorus14